Je vous présente Emily
Emily Maxwell est déjà apparue dans d'autres romans de Stewart O'Nan que je n'ai pas lus. De cet auteur j'ai lu par contre, et chroniqué, Des anges dans la neige et Derniers feux sur Sunset, très favorablement. Emily (Emily, alone en V.O) est l'héroïne de ce très beau roman. C'est une vieille dame, pas si fréquent en littérature. Veuve, elle vit à Pittsburgh, Pennsylvanie. Et tout le roman est une rencontre avec le quotidien de cette femme, disons middle-class, qui vit assez confortablement mais a l'habitude de faire attention. Elle soigne son chien Rufus qui lui coûte cher, plus très jeune lui non plus. Elle prend soin de sa voiture et avec sa belle-soeur, seule également, aime bien les expos et la musique classique.
Avec ses enfants éloignés c'est un peu difficile. Ses petits-enfants, elle ne les voit guère que our Thanksgiving ou Noël. Elle vit la vie de pas mal de vieilles dames seules. Elle fatigue un peu maintenant, Emily. Des souvenirs, des projets à sa mesure, une semaine par an de retrouvailles familiales, parfois décevantes. C'est donc une vie parmi d'autres que Stewart O'Nan, très fin observateur, nous invite à partager. Et je m'y suis senti bien, moi, dans la maison d'Emily, dans sa voiture malgré sa conduite mal assurée, à écouter ses coups de fil à ses enfants, à partager sa peine lors des mauvaises nouvelles de ses amies de son âge. 44 ans de profession de santé et des milliers de soins à domicile m'ont rendu sensible à la gériatrie.
Bien sûr le temps passe et l'inquiétude grandit. O'Nan nous a si bien installés dans le récit, au plus près, des jours d'Emily. Ici un malaise, là une perte d'équilibre en son cher jardin. Peu de romans se penchent ainsi sur les aînés. De courts chapitres tels les jours et les heures d'Emily. La vie reste assez douce pour Emily, de bons voisins, un véto empathique avec Rufus, une femme de ménage de confiance. Mais le trouble demeure. Il n'est facile nulle part d'avancer, passé certaines bornes.
Jamais grandiloquent, surtout pas ruisselant de pathos, terriblement humain, Emily est un livre d'une limpidité bouleversante. Bon sang, qu'est-ce que c'est formidable la littérature parfois.






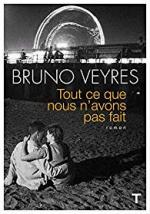

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F6%2F167745.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F26%2F98%2F197624%2F92964159_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F30%2F44%2F197624%2F89898499_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F90%2F21%2F197624%2F73138417_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F34%2F13%2F197624%2F72893683_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F95%2F34%2F197624%2F48126630_o.jpeg)